Définition
Pour définir le son on dit que c’est une vibration de l’air (c’est à dire une suite de surpressions et de dépressions de l’air par rapport à la pression atmosphérique moyenne).
L’onde acoustique est donc produite par la vibration d’un support fluide ou solide (dans le cas qui nous intéresse ce sont les cordes du piano). Une expérience simple avec un réveil (bruyant !) peut permettre de s’en rendre compte : si on place ce réveil dans une cloche à vide, ce réveil n’émet plus un bruit s’il n’est plus entouré d’air. Cette onde se propage ensuite dans le milieu environnant sous forme d’ondes longitudinales - ondes provoquant une perturbation dont la direction est parallèle à la direction de propagation de l’onde comme par exemple les ondes produites par le relâchement brutal d’un élastique étiré.
Par extension le mot « son » désigne la sensation auditive que cette vibration peut créer en arrivant aux oreilles d’un quelconque auditeur. Notre oreille perçoit les ondes sonores dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz environ. Les infrasons ont des fréquences inférieures à 20Hz et les ultrasons sont supérieurs à 20 kHz.
Onde stationnaire
Définition et caractéristiques
Si on produit un ébranlement en un point d’un milieu, cet ébranlement se transmet de proche en proche à tous les points de ce milieu. On dit alors qu’une « onde » se propage.
Il existe différents types d’ondes :
Les ondes transversales provoquent une perturbation perpendiculaire à la direction du déplacement. C’est le cas qu’on peut observer quand on jette une pierre dans l’eau, car chaque point de la surface de l’eau subit un déplacement perpendiculaire à la surface (une vague !) lorsque l’onde l’atteint.
Lorsque le déplacement provoqué est parallèle au déplacement, l’onde est dite longitudinale. C’est le cas des ondes sonores.
Une onde dont la trajectoire n’a pas été modifiée depuis son point d’émission s’appelle une onde incidente. Au contraire, si, après avoir heurté un mur par exemple, elle se déplace dans le sens opposé, alors elle s’appelle une onde réfléchie.
Si un milieu de propagation est limité, toute onde issue d’une source d’ébranlement se réfléchit quand elle arrive aux limites du milieu de propagation. Pour un ébranlement périodique (produit par exemple lorsqu’on souffle dans un instrument ou qu’on frappe ou pince des cordes pour produire de la musique), la superposition de l’onde directe (ou onde incidente) et de l’onde réfléchie peut donner lieu au phénomène d’onde stationnaire.
Le phénomène d’onde stationnaire fait que certains points du milieu restent continuellement au repos, ces points s’appellent des nœuds. Tandis que d’autres ont une amplitude maximale, ce sont les ventres.
Voici quelques caractéristiques de la propagation d’une onde :
Une onde se propage à partir de la source, dans toutes les directions qui lui sont offertes.
Deux ondes peuvent se croiser sans se perturber.
Les ondes sonores ne se propagent pas dans le vide car il n’y a pas de matière pour vibrer et transmettre la perturbation.
La propagation se transmet de proche en proche, sans transport de matière, mais avec transport d’énergie (un cri perçant peut briser un verre en cristal).
La célérité de l’onde est une propriété du milieu de propagation. Elle se calcule généralement par la formule :
V= d/t v, célérité de l’onde en m·s-1
d, la distance parcourue par l’onde en m
t, temps pendant lequel l’onde a parcouru la distance d en s
Il y a un cas particulier pour la vitesse de propagation de l’onde sur une corde :
V=F/2µ v, célérité de l’onde en m·s-1
F, tension de la corde en N
µ, masse linéique de la corde en Kg·m-1
- Facteurs de variation des caractéristiques
Les oscillations libres d’une corde de piano sont une superposition de fréquences appelées modes propres de vibrations. En modifiant la taille de la corde ou sa tension, on change les fréquences de ses modes propres et le son émis par le piano : plus une corde est tendue et courte, plus les longueurs d’onde seront courtes et plus les sons seront aigus ; alors que plus la corde sera large, détendue et longue, plus le son produit sera grave.
Table d'harmonie
La table d’harmonie est constituée d’un assemblage de petites planches en épicéa appelées des « épinettes » qui sont collées les unes aux autres pour former une large surface.
Table d’harmonie
La corde présente une surface trop petite pour produire un son correctement audible donc elle transmet sa vibration à la table d’harmonie par le chevalet. Celui-ci, grâce à sa position surélevée par rapport aux agrafes et aux points d’accroches des cordes, permet à la corde d’appuyer sur la table d’harmonie et de transmettre plus facilement son énergie vibratoire.
Elle est placée sur la ceinture du piano. Celle-ci est composée de plis de bois, possède la forme caractéristique des pianos à queue et peut aussi supporter le poids des autres constituants du piano. D’ailleurs les ceintures en contre plaqué peuvent atteindre jusqu’à 7 mètres pour les plus grands modèles de piano à queue.
C’est l’une des parties les plus importantes du mécanisme du piano. Son but est de transformer les vibrations des cordes en sons. C’est la « voix » du piano car c’est elle qui assure la production d’un son puissant et agréable et c’est la manière dont elle traduit les vibrations des cordes qui influence la qualité et le caractère du timbre de l’instrument.
Dans cette partie du piano, les matières utilisées sont de la plus grande importance pour la beauté du son. Dans les pianos de grande qualité, la table d’harmonie est réalisée en épicéa. L’épicéa est choisit en raison de son rapport élevé résistance/poids à cause de la tension d’environ 800 N des 250 cordes (chaque corde est tendue à environ 1000 N) exercée sur le sommier, lui-même en contact avec la table d’harmonie par le chevalet.
Le chevalet a deux rôles : déterminer à la fois la longueur vibrante de la corde (longueur entre le chevalet et les chevilles) et transmettre les vibrations à la table d’harmonie qui les amplifiera.
Les chevalets doivent être le plus possible au centre de la table car les bords de la table sont fixés et ne doivent pas vibrer. C’est la raison pour laquelle, sur les très grands pianos, les cordes n’atteignent pas le bout de la table, et pour laquelle on croise les cordes sur les pianos sur les pianos modernes (cela évite que les notes extrêmes soient trop près du bord de la table).
Barrage qui soutient la table d’harmonie (renforcé par des poutres en bois)
Caisse de résonance
Propagation du son
La vitesse de déplacement de l’onde sonore dépend de la pression, de la température et de la nature du milieu où elle se trouve. Ainsi dans l’air le son se déplace à environ 346 mètres par secondes si la température est de 20° C. Cette vitesse peut environ être arrondie à un kilomètre toutes les trois secondes.
Le son se déplace aussi à 1482 km/s dans l’eau et 5050 m/s dans l’acier. Cependant il ne se déplace pas dans le vide car dans le vide il n’y a pas d’atomes à faire vibrer, ni de matière pour supporter les ondes sonores.
Dans un milieu élastique – milieu qui reprend sa forme initiale une fois la perturbation passée – comme l’air, le son se propage sous la forme de variations de pressions créées par la source sonore. Ces variations se transmettent en faisant vibrer les atomes entourant cette source sans les déplacer (tout comme les vagues se déplacent sans modifier la place des molécules de l’eau sur la direction de la vague ). Ces vibrations s’appellent des phonons (énergie acoustique analogues du photon pour les ondes acoustiques).
Deux ondes de même direction mais de sens contraire peuvent se croiser sans se perturber l’une l’autre. C’est grâce à cette propriété qu’il est possible d’entendre l’écho par exemple.
Le son se réfléchit sur une surface lisse et dure comme la lumière sur un miroir. La réfraction du son fonctionne comme la réfraction de la lumière.
Plus un son est propagé, moins il est puissant car ses vibrations sont dissipées dans l’espace environnant la zone où il est produit. Selon l’angle d’après lequel le son est perçu, l’intensité est différente. Cette caractéristique permet notamment de distinguer le point d’origine d’un son car les deux oreilles le perçoivent avec des intensités différentes (celle la plus proche l’entend plus fort que celle la plus éloignée).
Propagation du son
La puissance des ondes sonores peut être atténuée grâce à certains matériaux appelés des isolants phoniques qui absorbent les ondes sonores comme par exemple le polystyrène expansé, le double vitrage (qui renforce les propriétés isolantes du verre), la laine de verre ou encore des teintures et des tissus.
Les propriétés de réfraction des ondes peuvent aussi être utilisées dans la fabrication de cornets acoustiques, par exemple, pour permettre aux auditeurs de percevoir plus facilement les sons grâce à la structure en V de ces instruments. En effet les ondes se répercutent sur les bords et se propagent facilement vers l’oreille de l’utilisateur sans se disperser car elles n’ont pas assez d’espace pour s’éparpiller.
Phénomène de résonance
Un système physique, qui peut être magnétique, électrique ou mécanique, comme dans le cas qui nous intéresse, est dit résonnant lorsqu’il est susceptible de modifier son état d’équilibre et d’emmagasiner de l’énergie, sous l’influence d’une sollicitation externe à une fréquence bien particulière. Cette fréquence correspond à la fréquence de résonance du système.
Le système mécanique que constitue une balançoire est un bon exemple de système résonnant. Tout enfant a pu éprouver par lui-même ce phénomène de résonance : s’il s’agite de façon désordonnée sur la balançoire, il ne se passe pas grand chose. S’il s’agite en donnant des impulsions (par son propre mouvement) à une fréquence quelconque qu’il a décidée lui, il ne se passe toujours pas grand chose. Par contre, s’il donne des impulsions à une fréquence qui correspond à la période d’oscillation de la balançoire (période qui rappelons-le est définie par sa masse, par la longueur du câble qui suspend la balançoire et la constante de gravité), la balançoire entre dans un mouvement oscillant dont l’amplitude va croissant avec la quantité d’énergie que l’enfant apporte. A la cessation de cette phase « d’excitation » du système, celui-ci revient à sa position d’équilibre avec un mouvement sinusoïdal amorti, à la fréquence d’oscillation de la balançoire. Cette fréquence d’oscillation est la fréquence de résonance du système.
De la même manière, un signal sonore provenant, à faible intensité, de la table d’harmonie s’amplifie dans la caisse de résonance du piano.
En effet, lors d’une excitation, des oscillations se propagent dans la structure et rebondissent sur les bords.
Comme les vagues sur la mer, les vagues peuvent se croiser sans s’influencer mais il peut arriver à certaines fréquences que ces vibrations se combinent après avoir rebondi sur des bords opposées.
Elles deviennent alors des ondes stationnaires, c’est-à-dire qu’elles ne se propagent alors plus mais oscillent sur place dans la structure. Il se produit en fait une conjugaison à cause de la rencontre de deux ondes sinusoïdales se propageant en sens inverse : la résultante est bien stationnaire et d’amplitude double au moment où les ondes incidentes et réfléchies sont en phase.
II Particularité du son émis par un piano


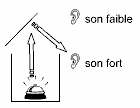
 Retour à la page d'accueil
Retour à la page d'accueil